
Algeria
Central Africa
Sierra Leone
Zimbabwe
Asia
Burma/Myanmar
Cambodia
Central Asia
Indonesia
Balkans
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Issues
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Latin America
Colombia
 
|
|||||||
|
Tribunal p´┐Żnal international pour le Rwanda: l'urgence de juger
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS Bient´┐Żt sept ans apr´┐Żs sa cr´┐Żation, imm´┐Żdiatement apr´┐Żs le g´┐Żnocide rwandais et plus de quatre ans apr´┐Żs le d´┐Żbut des premiers proc´┐Żs, le Tribunal p´┐Żnal international pour le Rwanda (TPIR) situ´┐Ż ´┐Ż Arusha, Tanzanie, n´┐Ża jug´┐Ż, ´┐Ż ce jour, que neuf individus. Quarante-cinq interpellations ont eu lieu pour soixante-cinq mises en accusation. Aucun des grands planificateurs pr´┐Żsum´┐Żs du g´┐Żnocide n´┐Ża ´┐Żt´┐Ż jug´┐Ż, y compris le colonel Th´┐Żoneste Bagosora, en prison depuis 5 ans. La plupart des vrais cerveaux du g´┐Żnocide, qu'ils soient officiellement recherch´┐Żs par le TPIR ou non faute de preuve, circulent librement entre diff´┐Żrents pays, dont la RDC, le Gabon, le Kenya, mais aussi la France et la Belgique. Avec un effectif de plus de 800 employ´┐Żs, trois chambres de premi´┐Żre instance occupant neuf juges et un budget d´┐Żenviron 90 millions de dollars am´┐Żricains, le bilan du TPIR est lamentable. Entre juillet 1999 et octobre 2000, la seule activit´┐Ż judiciaire au fond s´┐Żest r´┐Żduite au proc´┐Żs d´┐Żun seul accus´┐Ż, Ignace Bagilishema, ancien maire de la commune de Mabanza, au Rwanda, dont le verdict devrait ´┐Żtre rendu le 7 juin. Cinq juges sur neuf ont alors pass´┐Ż plus d´┐Żun an et demi sans proc´┐Żs au fond, l´┐Żun d´┐Żentre eux r´┐Żussissant en mars dernier ´┐Ż atteindre le record de vingt huit mois sans proc´┐Żs. A l´┐Żactif du TPIR, il faut compter la reconnaissance incontestable du g´┐Żnocide rwandais et la neutralisation politique internationale de l´┐Żagenda ´┐Żradicateur des Tutsi du ´┐Ż Hutu Power ´┐Ż. Cependant, sept ans plus tard, le travail du Tribunal n´┐Ża pas r´┐Żussi ´┐Ż davantage faire la lumi´┐Żre sur le plan, le m´┐Żcanisme, la chronologie, l´┐Żorganisation et le financement du g´┐Żnocide, ni ´┐Ż en identifier les vrais auteurs. Par comparaison avec le Tribunal pour l´┐Żex-Yougoslavie, le TPIR a souffert d´┐Żun d´┐Żsint´┐Żr´┐Żt international et d´┐Żun abandon m´┐Żdiatique choquant. Cela est en partie du au fait que la comp´┐Żtence du TPIR est de juger exclusivement les crimes commis en 1994, ´┐Ż la diff´┐Żrence du TPIY dont la comp´┐Żtence est ind´┐Żfinie dans le temps. L´┐Żexistence symbolique du tribunal n´┐Ża pas non plus d´┐Żcourag´┐Ż la persistance de protections dont b´┐Żn´┐Żficie dans certaines capitales (Kinshasa, Brazzaville, Nairobi, entre autres) plus d´┐Żune douzaine de puissantes personnalit´┐Żs hutu rwandaises figurant parmi les principaux suspects du g´┐Żnocide. Enfin, il ne semble pas avoir eu d´┐Żeffet dissuasif sur les acteurs du g´┐Żnocide de 1994 et de la guerre au Rwanda entre l´┐Żancien gouvernement d´┐ŻHabyarimana et le Front Patriotique Rwandais. Les perp´┐Żtrateurs du g´┐Żnocide se sont r´┐Żarm´┐Żs en toute impunit´┐Ż dans les camps de r´┐Żfugi´┐Żs de l'est du Congo, menant ´┐Ż la reprise de la guerre par le FPR en 1996 puis en 1998 sur le territoire de la RDC, o´┐Ż des crimes de guerre et des crimes contre l´┐Żhumanit´┐Ż ont continu´┐Ż d´┐Ż´┐Żtre commis par tous les acteurs. Il n´┐Żest certainement pas de la responsabilit´┐Ż des juges du TPIR d´┐Ż´┐Żcrire l´┐Żhistoire. Mais la faillite de leur t´┐Żche essentielle, rendre justice rapidement et ´┐Żtablir la m´┐Żmoire des faits, les emp´┐Żche de contribuer ´┐Ż remplir un des mandats qui leur a ´┐Żt´┐Ż donn´┐Ż par le Conseil de s´┐Żcurit´┐Ż : la r´┐Żconciliation nationale entre les communaut´┐Żs hutu et tutsi. Il est vrai que la pertinence politique du mandat a ´┐Żt´┐Ż vite d´┐Żpass´┐Że par la continuation et la r´┐Żgionalisation du conflit. Mais il reste que pour la majorit´┐Ż des Rwandais, le TPIR est une institution co´┐Żteuse et inefficace, un m´┐Żcanisme expiatoire de la communaut´┐Ż internationale pour faire oublier ses responsabilit´┐Żs dans l´┐Żex´┐Żcution du g´┐Żnocide et sa tol´┐Żrance des crimes du FPR. Le gouvernement rwandais se plaint du gaspillage d´┐Żargent et de moyens alors que 130 000 prisonniers surpeuplent les prisons du pays et que la justice rwandaise a jug´┐Ż plus de 4000 accus´┐Żs; les survivants du g´┐Żnocide le trouvent lointain et indiff´┐Żrent ´┐Ż leur sort, tandis que les victimes des crimes du FPR d´┐Żnoncent son instrumentalisation par le r´┐Żgime de Kigali et voient le TPIR comme le symbole d´┐Żune justice de vainqueur. L'urgence du mandat du TPIR semble avoir ´┐Żt´┐Ż oubli´┐Że dans les disfonctionnements quotidiens et les combats bureaucratiques internes. L'´┐Żclatement g´┐Żographique du bureau du Procureur entre Arusha, Kigali et la Haye a s´┐Żrieusement ralenti les enqu´┐Żtes, et les absences prolong´┐Żes des juges ou des avocats de la d´┐Żfense ont entrav´┐Ż la tenue des proc´┐Żs. En cons´┐Żquence, aujourd'hui il existe un vrai risque que les accus´┐Żs en d´┐Żtention soient rel´┐Żch´┐Żs faute de proc´┐Żs apr´┐Żs plusieurs ann´┐Żes. Le TPIR doit donc se limiter ´┐Ż l´┐Żurgence d´┐Żachever son mandat. Le Conseil de s´┐Żcurit´┐Ż doit demander au parquet de publier sans tarder une strat´┐Żgie d'enqu´┐Żtes et fixer une date limite raisonnable aux poursuites contre les suspects rwandais et demander aux juges de publier un calendrier des proc´┐Żs. De jour en jour, la mission du TPIR devient de plus en plus historique et a de moins en moins de chances d'avoir un impact symbolique sur le pr´┐Żsent. Tol´┐Żrer une telle situation et la cautionner plus longtemps reviendrait ´┐Ż une deuxi´┐Żme trahison du peuple rwandais. Mais surtout, ´┐Ż court terme, il est imp´┐Żratif d´┐Ż´┐Żtablir des priorit´┐Żs entre les affaires pendantes et de juger ceux qui sont d´┐Żj´┐Ż en d´┐Żtention. Trois des groupes cl´┐Żs sur lesquels les r´┐Żseaux extr´┐Żmistes hutu de l'ancien pouvoir rwandais se sont appuy´┐Żs sont l´┐Żarm´┐Że, le gouvernement int´┐Żrimaire et les m´┐Żdias. Le proc´┐Żs des m´┐Żdias est en cours. Il est urgent de faire d´┐Żmarrer celui des militaires, lesquels ont, comme le colonel Bagosora, pour la plupart d´┐Żj´┐Ż pass´┐Ż plusieurs ann´┐Żes en prison. Il s´┐Żagit d´┐Żun proc´┐Żs de la plus grande importance ´┐Ż tous ´┐Żgards et notamment quant ´┐Ż la preuve du plan et du m´┐Żcanisme du g´┐Żnocide. Il faut aussi que les proc´┐Żs des anciens ministres du gouvernement interimaire commencent le plus t´┐Żt possible. D´┐Żs les grands proc´┐Żs du g´┐Żnocide termin´┐Żs, le TPIR devra entreprendre sans tarder les proc´┐Żs sur les crimes commis en 1994 par le FPR. Malgr´┐Ż l'annonce publique du d´┐Żbut des poursuites et la d´┐Żclaration de collaboration du gouvernement rwandais, il faut s'attendre ´┐Ż ce que l'enqu´┐Żte ait des limites s´┐Żrieuses. On peut difficilement attendre d'un pouvoir en exercice qu'il l´┐Żve l'immunit´┐Ż de facto de ses militaires, alors que ceux ci continuent la guerre en RDC. Il est n´┐Żanmoins capital de mettre en demeure le r´┐Żgime de Kigali de livrer les criminels ´┐Ż la justice internationale et ainsi d'envoyer des signaux politiques forts en faisant comprendre qu'aucun crime, ni du pass´┐Ż ni du pr´┐Żsent ne restera impuni. Si la communaut´┐Ż internationale veut s´┐Żrieusement rendre justice et lutter contre l´┐Żimpunit´┐Ż, elle doit urgemment r´┐Żformer le fonctionnement du TPIR. La s´┐Żlection des juges doit ´┐Żtre revue pour ne retenir que des juges ayant une r´┐Żelle exp´┐Żrience professionnelle en mati´┐Żre p´┐Żnale. Ils doivent ´┐Żtre rendus comptables de leur activit´┐Ż et de leur performance. L´┐Żind´┐Żpendance du bureau du procureur doit ´┐Żtre renforc´┐Że et les ´┐Żl´┐Żments incomp´┐Żtents du greffe et du parquet limog´┐Żs. Parall´┐Żlement, la collaboration internationale entre les Etats et le TPIR doit ´┐Żtre renforc´┐Że pour l´┐Żarrestation et le transfert urgents des fugitifs. Les juridictions nationales devraient utiliser ou ´┐Żtendre leur comp´┐Żtence universelle pour juger les criminels rwandais encore en fuite, afin d´┐Żacc´┐Żl´┐Żrer le cours universel de la justice p´┐Żnale internationale. L'exemple des quatre proc´┐Żs tenus en Belgique d'avril ´┐Ż juin 2001 sous une loi de 1993 donnant ´┐Ż la justice belge une comp´┐Żtence universelle, est ´┐Ż promouvoir et encourager. Dans l´┐Ż´┐Żtat actuel de son fonctionnement et devant l´┐Żampleur de la t´┐Żche, il est illusoire de concevoir un ´┐Żlargissement imm´┐Żdiat du mandat du TPIR aux crimes commis en RDC en 1996-1997 ou au Burundi comme certains le proposent. Les juridictions nationales peuvent aussi juger les crimes commis au Burundi depuis 1993 et au Congo depuis 1995, avant que la Cour permanente internationale ne soit ´┐Żtablie et ne puisse prendre le relais. On pourrait ´┐Żgalement envisager la cr´┐Żation de cours sp´┐Żciales de comp´┐Żtence mixte, ´┐Ż l'example de celles propos´┐Żes pour la Sierra L´┐Żone ou le Cambodge. La question de l'´┐Żlargissement du Tribunal pourrait ´┐Żtre reconsid´┐Żr´┐Że ´┐Ż l'avenir, si le Tribunal parvient ´┐Ż rapidement achever son mandat. Enfin, la justice internationale doit rendre sa place aux victimes. Il faut transf´┐Żrer certains proc´┐Żs ´┐Ż Kigali et ´┐Ż d´┐Żfaut certaines audiences, pour accro´┐Żtre l´┐Żimpact sur la population rwandaise. Le r´┐Żglement de la question de l´┐Żindemnisation des victimes par la cr´┐Żation d'un fonds international est ´┐Żgalement urgent. RECOMMANDATIONS Au Conseil de s´┐Żcurite et au S´┐Żcretariat de l´┐ŻOrganisation des Nations Unies 1. Demander au Procureur de pr´┐Żsenter un ´┐Żch´┐Żancier pour la fin des enqu´┐Żtes en s'assurant que l'arrestation des planificateurs du g´┐Żnocide est une priorit´┐Ż. Demander aux juges de pr´┐Żsenter un calendrier judiciaire ´┐Żtablissant des priorit´┐Żs, et d'entamer sans tarder les proc´┐Żs des membres du gouvernement int´┐Żrimaire, des anciens officiers sup´┐Żrieurs de l´┐Żarm´┐Że et des responsables politiques locaux d´┐Żj´┐Ż en d´┐Żtention. S´┐Żassurer que la politique criminelle du Tribunal est conforme aux objectifs proclam´┐Żs et que des moyens efficaces d´┐Żenqu´┐Żte sont mis en oeuvre. 2. Passer une r´┐Żsolution obligeant tous les Etats qui tol´┐Żrent l´┐Żexistence des 17 fugitifs sur leur territoire de mettre tout en oeuvre pour arr´┐Żter et transf´┐Żrer ces personnes ´┐Ż Arusha, sous peine de sanctions. Le nom de ces Etats doit ´┐Żtre cit´┐Ż dans la r´┐Żsolution. 3. Pr´┐Żsenter des rapports semestriels sur l'activit´┐Ż du TPIR et des juges. 4. Doter simultan´┐Żment le bureau du procureur d´┐Żune autonomie d´┐Żaction et d´┐Żune autonomie financi´┐Żre pour la conduite des enqu´┐Żtes et l´┐Ż´┐Żmission de mandats internationaux. 5. Cr´┐Żer une commission charg´┐Że d´┐Ż´┐Żtudier la question de l´┐Żindemnisation des victimes du g´┐Żnocide en tenant compte des initiatives d´┐Żj´┐Ż prises en la mati´┐Żre par le greffe du tribunal et le gouvernement rwandais. Ce dossier complexe doit ´┐Żtre retir´┐Ż des seules mains du Tribunal. Cette commission pourrait envisager la cr´┐Żation d'un Fonds international, pr´┐Żsid´┐Ż par un Conseil d'´┐Żminentes personnalit´┐Żs. Aux Etats membres de l´┐ŻONU Sur la recherche et l´┐Żarrestation des fugitifs 6. Faire de l´┐Żarrestation des suspects une priorit´┐Ż politique et financi´┐Żre pour les polices nationales. Renforcer leur assistance au TPIR dans la recherche et l´┐Żinterpellation des suspects, et exercer une pression diplomatique sur ceux sur le territoire desquels ces suspects sont soup´┐Żonn´┐Żs d´┐Żavoir trouver refuge ou protection, comme le Kenya (cas Kabuga), le Congo-Brazzaville et la R´┐Żpublique d´┐Żmocratique du Congo (cas Bizimungu, Ntiwiragabo, Mpiranya et Renzaho) et le Cameroun (cas Mpiranya). Sur les transferts de suspects 7. Transf´┐Żrer les personnes accus´┐Żes par le tribunal dans les plus brefs d´┐Żlais et dans le respect du droit, ´┐Ż d´┐Żfaut d´┐Żint´┐Żgrer une proc´┐Żdure sp´┐Żciale. Sur la protection des t´┐Żmoins 8. Renforcer les moyens de protection dont dispose le Tribunal en offrant ´┐Ż celui-ci l´┐Żassurance de disposer, lorsque cela est n´┐Żcessaire, de facilit´┐Żs pour r´┐Żinstaller dans un autre lieu g´┐Żographique des t´┐Żmoins ayant comparu devant lui ou, le cas ´┐Żch´┐Żant, des informateurs du bureau du procureur. Sur le jugement des pr´┐Żsum´┐Żs g´┐Żnocidaires 9. Encourager les Etats ´┐Ż adapter leur juridiction nationale pour, ´┐Ż l´┐Żinstar de la Belgique, avoir une comp´┐Żtence universelle et juger les auteurs de g´┐Żnocide. Sur l´┐Żex´┐Żcution des peines 10. Encourager diplomatiquement les Etats africains ´┐Ż recevoir favorablement les demandes de coop´┐Żration du TPIR en mati´┐Żre d´┐Żex´┐Żcution des peines et soutenir financi´┐Żrement dans le cadre de programmes de coop´┐Żration judiciaire ceux qui s´┐Żengagent ´┐Ż recevoir les condamn´┐Żs du TPIR. Aux Etats bailleurs de fonds du Tribunal 11. Demander un audit public des comptes du Tribunal Au gouvernements francais et belge 12. Ouvrir des enqu´┐Żtes sur les suspects se trouvant aujourd´┐Żhui en France et en Belgique, comme la famille du pr´┐Żsident Havyarimana, qu'ils soient officiellement sur la liste de suspects du Tribunal ou non, et acc´┐Żl´┐Żrer les proc´┐Żdures d´┐Żj´┐Ż engag´┐Żes comme dans le cas du pr´┐Żtre Wenceslas Munyeshaka. Au gouvernement des Etats unis 13. Cr´┐Żer une mission d´┐Żinformation aupr´┐Żs des services du bureau du procureur sur l´┐Żutilisation concr´┐Żte des fonds du programme de r´┐Żcompenses ´┐Ż la d´┐Żlation des suspects du TPIR.
Au Procureur et la Pr´┐Żsidente du TPIR Sur les arrestations 14. Clarifier et simplifier l'´┐Żmission de mandats d'arr´┐Żt et le cas ´┐Żch´┐Żant, informer le Conseil de s´┐Żcurit´┐Ż de la non coop´┐Żration de certains ´┐Żtats s'il est d´┐Żmontr´┐Ż qu'ils h´┐Żbergent des suspects recherch´┐Żs par le Tribunal en toute connaissance de cause. 15. Pr´┐Żsenter un ´┐Żch´┐Żancier pour la fin des enqu´┐Żtes et un calendrier judiciaire pour les proc´┐Żs des personnes en d´┐Żtention. 16. R´┐Żsoudre de toute urgence les probl´┐Żmes observ´┐Żs entre le bureau du greffier et celui du procureur adjoint dans l'allocation des fonds, en dotant notamment le bureau du procureur d´┐Żune autonomie financi´┐Żre. Sur la coop´┐Żration judiciaire avec le Rwanda 17. Renforcer ses initiatives en mati´┐Żre de coop´┐Żration judiciaire avec les juridictions nationales rwandaises. Les missions de jeunes juristes ou de repr´┐Żsentants des milieux judiciaires rwandais ´┐Ż Arusha doivent ´┐Żtre d´┐Żvelopp´┐Żes. L´┐Ż´┐Żchange d´┐Żinformation entre les deux processus judiciaires en cours doit ´┐Żtre favoris´┐Ż. Sur le Outreach Program 18. Solliciter des fonds suppl´┐Żmentaires et renforcer les projets entam´┐Żs au cours de l´┐Żann´┐Że 2000 s´┐Żinscrivant dans le cadre du ´┐Ż outreach program ´┐Ż visant ´┐Ż am´┐Żliorer l´┐Żinformation sur les travaux du TPIR aupr´┐Żs des Rwandais. Sur l´┐Żorganisation de proc´┐Żs ´┐Ż Kigali 19. Organiser au plus vite certains proc´┐Żs du TPIR ´┐Ż Kigali pour augmenter l´┐Żimpact sur la population rwandaise. Si le transfert des proc´┐Żs est trop co´┐Żteux ou incompatibles avec les droits de la d´┐Żfense, il est urgent de transf´┐Żrer au moins certaines audiences ´┐Ż Kigali. Sur les retards et le fonctionnement du Tribunal 20. Mettre fin aux retards injustifiables qui ont caract´┐Żris´┐Ż l´┐Żactivit´┐Ż du Tribunal au cours des deux derni´┐Żres ann´┐Żes et remplir le mandat qui lui a ´┐Żt´┐Ż confi´┐Ż avec c´┐Żl´┐Żrit´┐Ż en obligeant toutes les chambres de premi´┐Żre instance a d´┐Żmarrer les proc´┐Żs au fond et contraindre la chambre d´┐Żappel ´┐Ż acc´┐Żl´┐Żrer les proc´┐Żdures. 21. S´┐Żassurer du recrutement d´┐Żenqu´┐Żteurs et de juristes comp´┐Żtents et efficaces au bureau du Procureur. Au Greffe et aux chambres 22. Examiner la possibilit´┐Ż d'exiger que les avocats de la d´┐Żfense soient tenus d'´┐Żtablir leur r´┐Żsidence ´┐Ż Arusha d´┐Żs leur commission d'office, sauf ´┐Ż ´┐Żtre excus´┐Żs par le pr´┐Żsident de la chambre. Au gouvernement du Rwanda 23. Faciliter autant qu´┐Żil peut le travail du TPIR sur son sol et lui donner des garanties de coop´┐Żration, notamment en ce qui concerne les crimes commis par des ´┐Żl´┐Żments du FPR en 1994, en suspendant imm´┐Żdiatement les suspects de leurs fonctions, en les d´┐Żmobilisant et en les mettant en r´┐Żserve de la justice internationale. 24. Moderniser sa justice, notamment en termes d´┐Żex´┐Żcution des peines, pour encourager les pays de la r´┐Żgion ´┐Ż extrader les suspects de g´┐Żnocide vers le Rwanda. Nairobi/Arusha/Bruxelles, 7 juin 2001
Any comments about this publication? Click here
|
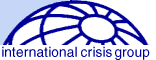
| ´┐ŻConsensual Democracy´┐Ż in Post Genocide Rwanda: Evaluating the March 2001 District Elections Report 9 October 2001 |
|
| Tribunal p´┐Żnal international pour le Rwanda: l'urgence de juger Report 7 June 2001 |
|
| International Criminal Tribunal for Rwanda: Justice Delayed (Original version in French) Report 7 June 2001 |
|
| Uganda and Rwanda: Friends or Enemies? Report 4 May 2000 |
|