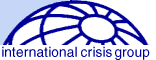|
|||||||
|
Burundi: sortir de l'impasse. L'urgence d'un nouveau cadre de negociations
SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS La tentative de coup d'�tat perp�tr�e par un groupe de jeunes officiers de l�arm�e burundaise contre le Pr�sident Pierre Buyoya le 18 avril 2001 est un signal d�alarme pour le processus de paix. Celui-ci est dans une impasse, plus de huit mois apr�s la signature d�un accord-cadre � Arusha en ao�t 2000. Les questions laiss�es en suspens n'ont toujours pas �t� r�gl�es et les conditions de son application ne sont toujours pas r�unies. Aucun cessez-le-feu entre l'arm�e et la r�bellion n'est en vue et le leadership de transition n�a pas �t� d�sign�. De plus, la Commission de suivi et d�application de l�accord (CSAA) s�annonce comme une institution co�teuse, inefficace, incapable de remplir sa mission. Mandela, malgr� le soutien des chefs d'Etat de la r�gion et de la communaut� internationale, a jusqu'� pr�sent �chou� � faire accepter l'accord d'Arusha aux groupes rebelles et � les faire renoncer � la violence. Loin de les avoir convaincus de rejoindre les n�gociations, la mort de Laurent D�sir� Kabila a d�cid� les rebelles � passer � l'offensive pr�par�e depuis longtemps contre le Burundi, qui reste le maillon faible de l'alliance anti-Kinshasa. D'une situation de "ni guerre ni paix" , le Burundi risque de retourner � une situation de guerre civile g�n�ralis�e. Aujourd'hui l'arm�e et les rebelles mobilisent toutes leur ressources et se pr�parent � un affrontement majeur. Pendant ce temps, la com�die des partis politiques continue. Aucun des sc�narios de transition propos�s actuellement, avec les tandems pr�sident/vice pr�sident ou ex-Ministre de l'Int�rieur/ex-Secr�taire gen�ral du FRODEBU ne permettront une application impartiale et satisfaisante de l�accord de paix. La premi�re n�est qu�une dangereuse poursuite du statu quo, et repr�sente la r�sistance du r�gime � quitter le pouvoir, tandis que la seconde, qui refl�te certes une �vidente volont� de changement � la t�te de l'Etat, ne conduira qu'� une nouvelle "gu�rilla" institutionnelle. Dans ce contexte de d�t�rioration de la s�curit�, de catastrophe humanitaire et de fragmentation politique dans les deux camps, les maigres acquis d'Arusha fondent comme une peau de chagrin. Bien que portant une part de responsabilit� dans ce blocage, le pr�sident Buyoya devient la cible id�ale de toutes les rancoeurs et le risque de son �limination physique devient r�elle. Un tel �v�nement serait catastrophique. Il provoquerait sans aucun doute des r�glements de compte entre leaders politiques, et une violence ethnique incontr�l�e. Il serait donc contre-productif de pousser aujourd�hui � l'application de l�accord d�Arusha, alors que les n�gociations de paix sont inachev�es et que le pays se trouve sous la menace des bellig�rants. Cependant, le statu quo est tout aussi dangereux. Le pourrissement de la situation interne exige une sortie urgente de l'impasse au risque d�un effondrement complet du processus de paix. Un changement radical de la gestion des n�gociations s�impose. Nelson Mandela doit offrir � Pierre Buyoya une sortie honorable du pouvoir mais obtenir �galement des garanties sur le d�mant�lement des bastions de l�oligarchie politico-militaire qui l�entoure. Le d�part de l�homme n�est pas en soi une garantie d�effondrement du syst�me. Le partage du pouvoir doit ainsi �tre n�goci� directement entre l�UPRONA et le FRODEBU, � l'exclusion de tous les autres partis politiques. Cet accord doit �tre scell� par l��laboration d�une constitution de transition, �vacuant le risque de "gu�rilla" institutionnelle entre les hommes politiques burundais au cours de la transition. Le fonctionnement du CSAA doit �galement �tre r�vis�. Un cessez-le-feu ne pourra pas �tre enfin obtenu tant qu�il n�y aura pas d�harmonisation entre les termes des processus de paix burundais et congolais, notamment sur la question des � forces n�gatives �, et tant que les Pr�sidents congolais et tanzanien Joseph Kabila et Benjamin Mkapa ne s�engageront pas personnellement � en faire aboutir les n�gociations. Une prime � l�arr�t des combats doit �tre pos�e sur la table des n�gociations par les donateurs internationaux et des sanctions cr�dibles doivent �tre pr�vues contre ceux qui s�y refusent. De m�me, au-del� de la r�gion, Nelson Mandela doit travailler � la formation d�un front international uni pour la r�solution du conflit burundais. Le Burundi ne peut pas se permettre de concurrence entre les m�diations anglophones et francophones, ou voir les leaders du PALIPEHUTU-FNL se pr�senter � Pretoria tandis que ceux du CNDD-FDD rencontrent le gouvernement burundais � Libreville pour n�gocier sur le th�me identique du cessez-le-feu et de la r�forme des forces arm�es. RECOMMANDATIONS Au Facilitateur Nelson Mandela: 1. Clarifier les responsabilit�s de m�diation entre Libreville et Pr�toria. Le Pr�sident Mandela pourrait n�gocier le d�part de Pierre Buyoya. Le vice-pr�sident Zuma pourrait terminer � Pretoria les n�gociations sur le partage du pouvoir entre l�UPRONA et le FRODEBU, et le Pr�sident Omar Bongo se charger du cessez-le-feu avec les FDD et les FNL. Cette redistribution des t�ches doit �tre ent�rin�e par les pays membres de l�Initiative r�gionale sur le Burundi. 2. Recruter une �quipe internationale de m�diateurs professionnels, travaillant � plein temps sur le dossier burundais. Nommer un agent de liaison avec le processus de Lusaka. 3. R�unir en Afrique du Sud les acteurs internationaux impliqu�s dans le processus de paix burundais (en particulier : les pays membres de l�Initiative r�gionale sur le Burundi, Omar Bongo du Gabon, les pr�sidents Joseph Kabila de la R�publique D�mocratique du Congo et Robert Mugabe du Zimbabwe, les membres permanents du Conseil de s�curit� et le Royaume de Belgique) pour des consultations sur l��laboration d�un front uni et d�une strat�gie commune de n�gociations sur la crise burundaise. 4. Inviter Pierre Buyoya sans d�lai en Afrique du Sud pour n�gocier les conditions de son d�part du pouvoir, qui devront �tre ensuite pr�sent�es au Conseil de s�curit� des Nations unies et endoss�es par la communaut� internationale. En cas de refus du pr�sident Buyoya, pr�voir des sanctions personnelles � son encontre (gel des avoirs �trangers, actions judiciaires, restrictions des capacit�s de d�placements � l��tranger, etc.) et demander au Conseil de s�curit� de passer une r�solution incitant les Etats membres de Nations unies � appliquer ces mesures. 5. Une fois obtenues des garanties sur le d�part de Pierre Buyoya, le nommer comme pr�sident de la premi�re p�riode de la transition et Domitien Ndayizeye comme vice-pr�sident sous condition de l�aboutissement de n�gociations directes de partage de pouvoir entre l�UPRONA et le FRODEBU et de l��laboration d�une constitution de transition. 6. R�unir l�UPRONA et le FRODEBU � huit clos pour �laborer une constitution de transition, et revoir le mode de fonctionnement du CSAA. Le r�sultat de cette n�gociation constituera l�Accord de Pretoria compl�mentaire de celui d�Arusha. Il sera soumis aux autres partis pour commentaires. 7. Soumettre le projet r�vis� de l�Accord de Pretoria aux dix-neuf signataires de l�Accord d�Arusha pour ratification. Les partis refusant de signer l�Accord de Pretoria seront exclus des institutions de transition. 8. Exiger simultan�ment de Jean-Bosco Ndayikengurukiye, Agathon Rwasa et de Pierre Buyoya une tr�ve imm�diate, pour engager sans d�lai et sans conditions des n�gociations sur un cessez-le-feu permanent et la r�forme des forces de s�curit�. Le r�sultat de cette n�gociation constituera l�Accord de Libreville compl�mentaire de ceux d�Arusha et de Pr�toria. 9. Faciliter les contacts entre le FRODEBU, le CNDD, et le FROLINA et les combattants d�sireux de d�poser les armes pour qu�ils en obtiennent un mandat et convoquer ces trois partis de m�me que le gouvernement Burundais pour l�ouverture des n�gociations sur la r�forme des forces de s�curit�. Le r�sultat de ces n�gociations constituera le protocole II des accords de Pretoria, devant �tre ratifi�s comme l�accord de Libreville. 10. Demander au gouvernement tanzanien l'ouverture d'une structure d�accueil, de recensement et d�identification des forces rebelles combattantes d�sireuses de d�poser les armes. Celles-ci devront �tre consid�r�es comme prioritaires pour la r�forme des forces arm�es et les programmes de r�insertion et doivent pouvoir choisir librement leur repr�sentant pour les n�gociations de Libreville sur la r�forme des forces de s�curit�. Aux Membres du Conseil de S�curit�: 11. Signer en tant qu�observateurs les Accords de Pretoria et de Libreville de m�me qu�un engagement de soutien actif � l�application de ces accords. 12. Demander l'arr�t imm�diat et inconditionnel du soutien aux FDD par le gouvernement de la RDC lors de la prochaine mission du Conseil de s�curit� en RDC. 13. En cas de refus des leaders FDD et FNL de d�clarer une tr�ve et de n�gocier sans conditions les modalit�s d�un cessez-le-feu et la r�forme des forces de s�curit�, mettre en place le dispositif suivant : Demander aux signataires de l�accord d'Arusha la condamnation des mouvements rebelles refusant les n�gociations, conform�ment � l�article 2.B du pr�ambule de l�accord d�Arusha; les qualifier officiellement de � forces n�gatives �; Demander au gouvernement de la RDC de cesser tout soutien � la rebellion burundaise sous peine de sanctions; Mettre en place avec le soutien de la communaut� internationale, des gouvernements de la R�publique unie de Tanzanie et de la R�publique du Congo, une unit� technique vou�e � l��laboration d�un plan de neutralisation et de d�sarmement de ces � forces n�gatives � burundaises en coordination avec la Commission Militaire Mixte de l'Accord de Lusaka ; Autoriser une force internationale d'observation sur la fronti�re burundo-tanzanienne et burundo-congolaise (sur les rives du Lac Tanganyika, et dans la plaine de la Rusizi, et dans les camps de r�fugi�s en Tanzanie). Cette force pourrait �tre une extension de la MONUC. Aux Bailleurs de Fonds du Burundi : 14. Commencer � d�bloquer les fonds promis � la conf�rence de Paris en d�cembre 2000 pour remettre progressivement sur pieds l��conomie productive, les secteurs de la sant� et de l��ducation et toute activit� qui met l'accent sur la d�centralisation. 15. Mettre en place un contr�le draconien de l�utilisation de cette aide pour �viter tout d�tournement et conditionner les d�boursements au d�mant�lement des situations de rente � l�origine du pouvoir de l�oligarchie politico-militaire. Nairobi/Bruxelles, 14 mai 2001 To view the executive summary of this report IN ENGLISH, please click here.
Any comments about this publication? Click here
|