
Algeria
Central Africa
Sierra Leone
Zimbabwe
Asia
Burma/Myanmar
Cambodia
Central Asia
Indonesia
Balkans
Albania
Bosnia
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Issues
EU
HIV/AIDS
Terrorism
Latin America
Colombia
 
|
|||||||
|
Assembl�e populaire nationale: 18 mois de l�gislature
L�annonce de la d�mission du Pr�sident Z�roual, en septembre 1998, constitue une premi�re dans la vie politique alg�rienne. Depuis l�ind�pendance du pays en 1962, c�est le premier chef de l�Etat, arriv� au pouvoir par les urnes, qui quitte pr�matur�ment la sc�ne politique en pr�parant sa succession par un scrutin. En attendant les r�sultats des �lections anticip�es, pr�vues pour avril 1999, l�Assembl�e Populaire nationale (APN), issue des �lections l�gislatives de juin 1997, fera face � un v�ritable test de stabilit�. Cette institution concentre les lignes de force et les clivages politiques qui traversent la soci�t� alg�rienne. Six ann�es apr�s les l�gislatives avort�es de d�cembre 1991, les Alg�riens ont �lu, dans un climat de violence chronique, la premi�re assembl�e pluraliste dans l�histoire du pays. Malgr� un scrutin controvers�, le paysage politique, fa�onn� par les �lections de juin 1997, se r�sume en trois grandes tendances non uniformes. La premi�re � nationaliste � est repr�sent�e par le FLN et le RND, deux partis non exempts de divisions internes quant aux strat�gies pour conserver un pouvoir de plus en plus vacillant. La seconde � islamiste � o� le MSP/Hamas et Nahdha sont les repr�sentants l�gaux du courant islamiste. Leurs objectifs strat�giques ne diff�rent pas de la volont� du FIS d�instaurer un Etat islamique bas� sur l�application de la Chari��a (loi coranique). La troisi�me � d�mocratique � est divis�e entre les � �radicateurs � (RCD) et les � r�conciliateurs � (FFS, PT) ce qui r�duit consid�rablement leur influence. Ils d�veloppent un discours qualifi� de � moderniste � : d�fense du pluralisme politique, culturel et linguistique, respect des droits de l�homme, �galit� de droits entre l�homme et la femme, rejet du code de la famille et s�paration des champs politiques et religieux. Leur influence dans l�adoption des projets de loi reste limit�e mais leur libert� de ton a r�ussi, � plusieurs reprises, � infl�chir la rigidit� et les r�flexes autoritaires du gouvernement. Au cours de ces dix-huit mois de fonctionnement, l�APN a enregistr� des signes positifs de progr�s vers la d�mocratie. Elle permet de donner une tribune � l�opposition et d�aborder des sujets sensibles comme la situation s�curitaire et le drame des personnes disparues. Mais la marge de man�uvre de l�APN dans l��laboration des lois et sa capacit� de contr�le sur l�ex�cutif restent limit�es malgr� ses pr�rogatives constitutionnelles. Ces insuffisances s�expliquent, entre autres, par le manque d�exp�rience dans le fonctionnement d�une telle assembl�e et le manque de transparence des �lus d�une majorit� issue des appareils du parti unique et de ses satellites. L�APN doit �tre un organe ind�pendant de l�ex�cutif qui ne sert pas d�alibi au pouvoir. Son fonctionnement et sa marge de libert�, dans des dossiers comme le code de la famille et le code de l�information, seront des param�tres d�terminant pour mesurer l�avanc�e de la d�mocratie en Alg�rie. Pour asseoir la l�gitimit� des institutions en place, il est imp�ratif que les �lections pr�sidentielles d�avril 1999 se d�roulent en toute transparence pour �viter les fraudes massives rencontr�es lors du scrutin de juin 1997. Le gouvernement alg�rien doit garantir une totale transparence durant tout le processus �lectoral et favoriser le d�bat politique entre les diff�rents candidats. Les partis politiques doivent avoir un acc�s libre et �gal aux m�dias. Le gouvernement alg�rien doit assurer la s�curit� de tous les candidats. Quant aux organisations internationales, elles doivent avoir un acc�s � l�ensemble du territoire avant, pendant et apr�s le scrutin.
Any comments about this publication? Click here
|
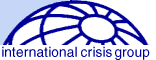
| Algeria's Economy: The Vicious Circle of Oil and Violence Report 26 October 2001 |
|
| The Civil Concord: A Peace Initiative Wasted (Original Version in French) Report 9 July 2001 |
|
| La Concorde civile: une initiative de paix manqu�e Report 9 July 2001 |
|
| The Algerian Crisis: Not Over Yet Report 20 October 2000 |
|
| La crise algerienne n'est pas finie Report 20 October 2000 |
|